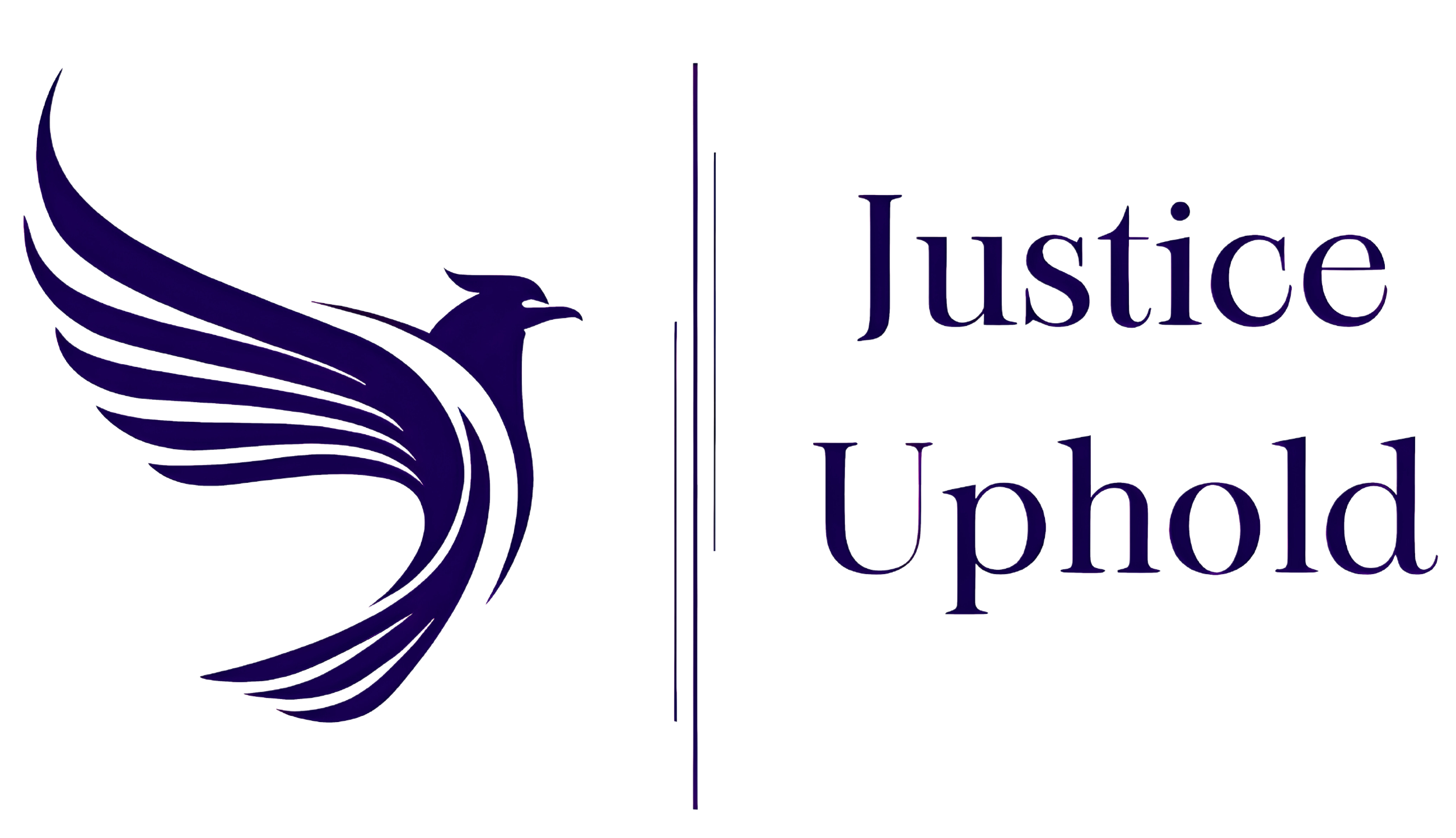La justice est le fondement indispensable de la dignité humaine. La Journée internationale du droit à un procès équitable, célébrée le 14 juin, est une occasion importante de rappeler la primauté du droit et l’inviolabilité des droits individuels. Le droit à un procès équitable n’est pas seulement le fondement des procédures judiciaires, mais aussi celui d’une société libre et égalitaire. En tant que juriste, je ne peux ignorer les graves violations des droits humains commises dans notre pays en cette journée importante.
Ce droit comprend le droit d’être jugé par des tribunaux indépendants et impartiaux, le droit à une défense efficace, le droit à une décision rendue dans un délai raisonnable et le droit à la présomption d’innocence. Malheureusement, en Turquie, il est devenu inévitable de constater que chacune de ces garanties fondamentales a été gravement érodée, en particulier ces dernières années. Nous vivons une période où la confiance dans l’indépendance des décisions judiciaires par rapport au climat politique s’affaiblit de plus en plus. En tant que juriste, les affaires auxquelles j’ai été confronté, où les décisions ont été prises davantage en fonction de la conjoncture que du fond, montrent de manière douloureuse à quel point la confiance dans la justice a été ébranlée.
Les procès où le droit à la défense est restreint, les cas où les prévenus en détention sont rencontrés par leurs avocats dans des conditions contraires au secret professionnel et les procédures visant à punir la défense montrent clairement à quel point l’institution de la défense est mise à mal. Or, il n’est pas possible de parler de justice dans un procès où la défense n’est pas efficace. Dans certaines audiences, la limitation du temps alloué à la défense, la non-communication en temps utile du contenu des dossiers ou l’impossibilité d’accéder aux preuves montrent que ce droit n’existe que sur le papier.
Le principe du jugement dans un délai raisonnable est quant à lui devenu un concept presque oublié. Des personnes contraintes d’attendre des années pour obtenir une décision tentent de mener leur vie dans l’incertitude. Il existe de nombreux dossiers dans lesquels les actes d’accusation n’ont pas été préparés pendant des années et les périodes de détention ont été prolongées de manière arbitraire. Depuis 2018, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu des décisions accordant des indemnités à des dizaines de juges et de procureurs pour détention prolongée et retard dans la présentation de l’acte d’accusation, mais ces violations n’ont pas été empêchées. En Turquie, la justice n’est pas seulement retardée, elle est presque au point mort. Lorsque la justice est retardée ou complètement défaillante, la conscience de la société commence à se dégrader. Car la justice ne trouve son sens véritable que lorsqu’elle est rendue en temps utile et de manière efficace. Chaque dossier judiciaire qui reste en suspens pendant des années met la vie d’une personne en suspens et a des répercussions négatives sur tous les aspects de sa vie, de sa famille à sa carrière, en passant par sa santé et ses espoirs. J’ai été témoin à maintes reprises des cris silencieux de personnes qui attendaient désespérément le jour de leur procès.
L’une des violations les plus graves est le non-respect de la présomption d’innocence. Le fait que des personnes qui n’ont pas encore été condamnées définitivement soient déclarées coupables dans les médias cause des dommages difficilement réparables à la société. Je constate avec tristesse que les personnes acquittées mais condamnées par l’opinion publique ne parviennent pas à se libérer pendant des années du stigmate dont elles sont victimes. La présomption d’innocence protège non seulement l’équité du procès, mais aussi la réputation sociale de l’individu. La violation de ce principe fondamental porte gravement atteinte à la légitimité du système judiciaire.
En commémorant le 14 juin, nous ne pouvons oublier les graves violations des droits de l’homme qui ont eu lieu, en particulier après 2016. Des milliers de juges, de procureurs, de policiers, de militaires, d’enseignants et de personnes appartenant à différentes professions ont été licenciés, arrêtés, leurs biens ont été confisqués, leurs biens privés ont été placés sous tutelle et leurs institutions ont été systématiquement pillées, sans qu’un procès équitable ait été mené. Ce processus a profondément ébranlé non seulement l’indépendance du pouvoir judiciaire, mais aussi le sentiment de justice de la société
. De plus, ces violations du droit se poursuivent aujourd’hui encore et créent un grave sentiment d’insécurité juridique dans toutes les couches de la société. La Turquie est malheureusement qualifiée de « prison à ciel ouvert » par l’opinion publique internationale. Dans un pays où les citoyens s’inquiètent pour leurs biens, leur vie et leur liberté, il est impossible de parler d’indépendance de la justice et d’un environnement sûr pour l’exercice des droits.
Aujourd’hui, en tant que juristes, nous savons que nous avons la lourde responsabilité de ne pas nous contenter de constater ces pertes, mais de lutter pour la reconstruction d’un ordre juridique équitable. Car la violation du droit à un procès équitable n’entraîne pas seulement des préjudices individuels, elle sape également les fondements mêmes de la démocratie. Le droit à un procès équitable est le plus souvent bafoué dans les États autoritaires. C’est pourquoi ce droit doit être retiré du champ du droit interne des États et faire l’objet d’une clarification et d’une garantie au niveau international. Cette responsabilité doit être la mission commune de toutes les instances internationales. En effet, les États ont parfois tendance, pour diverses raisons, à s’écarter de l’objectif d’équité de leurs procès. Il est donc du devoir des juristes de rappeler cette responsabilité aux organisations internationales.
Le droit à un procès équitable n’est pas seulement une garantie de liberté pour les accusés, mais aussi pour toute la société. Lorsque ce droit est bafoué, la démocratie est affaiblie et la vérité est étouffée. En tant que juriste, je renforce chaque jour davantage ma conviction que le principe d’un procès équitable doit être protégé. Car la justice ne s’impose pas par le silence, mais par une résistance déterminée. Si nous ne faisons pas entendre notre voix aujourd’hui, demain, même le silence deviendra une complicité. Fort de cette conviction, je crois que la lutte pour la justice n’est pas un choix, mais une obligation de protéger la dignité humaine.