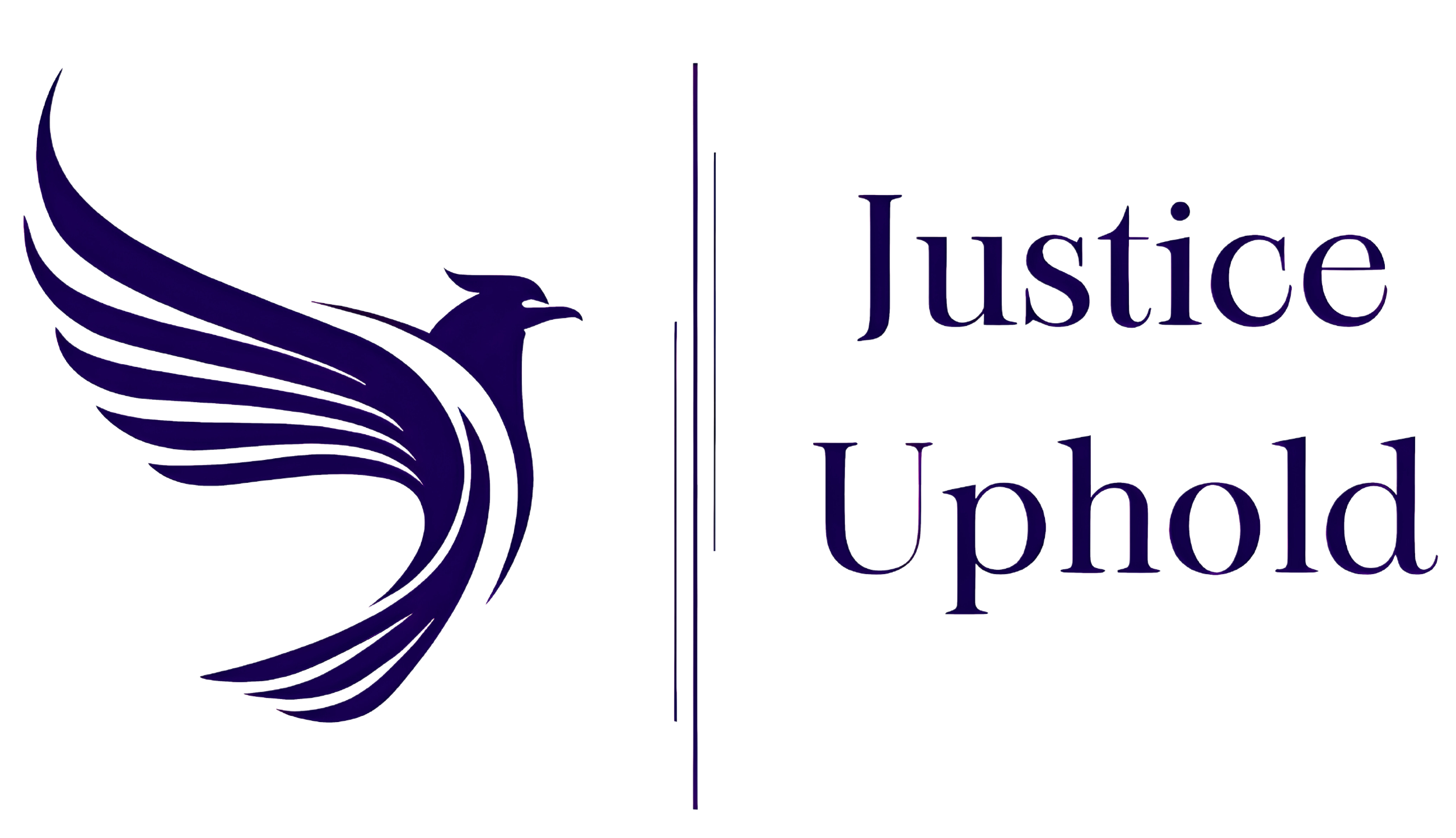Une étape historique pour le Conseil de l’Europe :
Convention sur la protection de la profession juridique adoptée

Le Conseil de l’Europe a adopté la première convention internationale visant à protéger la profession juridique. Cette mesure a été prise en réponse à des rapports faisant état d’attaques croissantes contre la profession juridique, qui peuvent prendre diverses formes, notamment le harcèlement, les menaces, les agressions physiques ou l’ingérence dans l’exercice des fonctions professionnelles (par exemple, le refus d’accès aux clients).
Les avocats jouent un rôle essentiel dans le respect de l’État de droit et dans la garantie de l’accès à la justice pour tous, ce qui inclut la réparation d’éventuelles violations des droits de l’homme. La confiance du public dans les systèmes judiciaires dépend donc fortement du rôle joué par les avocats.
La Convention du Conseil de l’Europe pour la protection de la profession d’avocat couvre les avocats et les organisations professionnelles qui défendent leurs droits et leurs intérêts. La Convention traite du droit d’exercer, des droits professionnels, de la liberté d’expression, de la discipline professionnelle et des mesures de protection spéciales pour les avocats et les organisations professionnelles.
En vertu de la Convention, les États parties sont tenus de veiller à ce que les avocats puissent s’acquitter de leurs obligations professionnelles sans faire l’objet d’attaques physiques, de menaces, de harcèlement, d’intimidations ou d’obstructions ou d’interférences inappropriées. Lorsque de telles situations peuvent constituer une infraction pénale, les États parties doivent mener une enquête efficace. En outre, les parties doivent veiller à ce que les organisations professionnelles fonctionnent comme des organismes indépendants et autonomes.
La convention sera ouverte à la signature lors de la réunion des ministres des affaires étrangères du Conseil de l’Europe qui se tiendra à Luxembourg le 13 mai.
Pour que la Convention entre en vigueur, au moins huit pays doivent la ratifier, dont au moins six doivent être membres du Conseil de l’Europe. La mise en œuvre de la Convention sera supervisée par un comité composé d’un groupe d’experts et de représentants des Etats parties.
Texte du contrat :
file:///home/victory/Downloads/eurocouncil of Europe_tr-1.pdf
/home/victory/Dokumente/JusticeUphold/Bülten/May Bulletin/eurocouncil of Europe_fr-1.pdf
Une première à la CEDH ;
EVALUATION DE L’AVIS DE TIERS SOUMIS PAR LE RAPPORTEUR SPECIAL DE L’ONU SUR LA DEMANDE « YASAK/TURQUIE ».

Le rapporteur spécial des Nations unies est un expert indépendant créé par la résolution 40/16 du Conseil des droits de l’homme, qui a pour mandat de promouvoir la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. À ce titre, le professeur Ben Saul veille au respect des principes du droit international en matière de droits de l’homme, en particulier l’interdiction de l’application rétroactive des peines. Dans ce contexte, il a rendu un avis de tiers dans l’affaire Yasak c. Turquie (n° 17389/20). En effet, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a remis en question la compatibilité de la condamnation du requérant pour appartenance à une organisation terroriste armée avec l’exigence de « prévisibilité » de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Dans ce contexte, le rapporteur spécial s’est efforcé de fournir à la Cour un avis sous l’angle du droit international, en abordant les implications pour les droits de l’homme des ambiguïtés de la définition des infractions terroristes et de l’application rétroactive du droit pénal (avis du rapporteur spécial, p. 6). L’avis du rapporteur spécial est analysé sous 6 rubriques, et la compatibilité de l’avis avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et, dans ce contexte, les évaluations concernant l’arrêt Yasak c. Turquie qui sera entendu par la Grande Chambre le 07/5/2025 sont incluses.
Il s’agissait d’une intervention pionnière dans les affaires en cours contre la Turquie devant la Cour européenne des droits de l’homme, qui a fait naître l’espoir d’une réévaluation de l’arrêt Ban.
Intervention critique en termes de droits de l’homme internationaux
L’avis soumis par le rapporteur spécial des Nations unies analysait l’affaire à la lumière des principes universels de protection des droits de l’homme dans le contexte de la lutte contre le terrorisme. L’avis du professeur Saul critique directement l’approche adoptée par la deuxième chambre de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Yasak et signale une violation de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) (principes de légalité et de prévisibilité).
Les points suivants ressortent particulièrement de l’avis :
– Définition vague du terrorisme : Il est indiqué que les activités liées au mouvement Gülen au cours de la période 2011-2014 ne peuvent être définies comme des « infractions terroristes » et que les activités au cours de cette période ne constituent pas clairement une infraction pénale.
– Absence d’élément moral de l’infraction : Il est souligné qu’il n’existe aucune preuve concrète que Yasak était au courant de la tentative de coup d’État, qui est l’objectif ultime de l’organisation, et que seules des hypothèses abstraites telles que « il aurait dû savoir » sont utilisées.
– Critique des activités secrètes : Il est indiqué que l’utilisation de « noms de code » et de comportements similaires peut être utilisée pour assurer la sécurité personnelle dans les régimes répressifs et que de telles actions ne devraient pas être automatiquement criminalisées.
– L’imprécision du TCK 314 : Il est indiqué que des critères tels que « la continuité, la diversité et l’intensité », qui permettent à de nombreuses personnes en Turquie d’être jugées selon les mêmes critères, sont utilisés de manière ambiguë et arbitraire.
Ce jugement devrait constituer un précédent pour des milliers d’affaires en Turquie.
L’avis du rapporteur spécial des Nations unies jette la lumière non seulement sur l’affaire Yasak, mais aussi sur des milliers d’affaires similaires déposées après le 15 juillet. Le rapporteur a constaté que dans la plupart de ces cas, l’intention criminelle individuelle n’a pas été examinée et que les peines ont été imposées dans une logique collective.
Dans ce contexte, l’arrêt de la Grande Chambre pourrait non seulement décider du sort de Şaban Yasak, mais aussi constituer un tournant juridique pour la liberté d’expression, la liberté de religion et le droit à un procès équitable en Turquie. »
Pour accéder au document d’avis :
097554080931910?t=d5Nwy3ghLDyc7C7OJ_LdBQ
Cliquez pour le texte complet :
Turc
Anglais
AUDITION SUR L' »INTERDICTION » DANS LA GRANDE CHAMBRE DE L’UEHM LE 7 MAI 2025

Le 27 août 2024, la Cour européenne des droits de l’homme a annoncé son arrêt dans l’affaire Yasak c. Turquie et a jugé que le principe « pas de crime et pas de peine sans loi » énoncé à l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) n’avait pas été violé à l’égard du requérant qui avait été condamné à une peine d’emprisonnement pour appartenance à une organisation terroriste armée en raison de ses liens avec le mouvement Gülen.
Après la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, une enquête fut ouverte contre le requérant Şaban Yasak sur la base de déclarations de témoins selon lesquelles il était un » talebe mesul de la grande région » et il fut arrêté pour appartenance à une organisation terroriste armée. Par la suite, l’acte d’accusation a inclus des preuves que le requérant avait un compte à la Bank Asya et que son nom était mentionné dans le dossier HTS provenant du dossier d’une autre personne accusée de la même infraction. Après deux sessions du procès, le requérant a été condamné pour appartenance à une organisation terroriste armée. Le jugement motivé était basé sur deux déclarations de témoins, le dossier HTS dans lequel son nom n’était mentionné qu’une seule fois et son compte à la Bank Asya. Par la suite, l’affaire a été confirmée par la Cour d’appel et la Cour de cassation, et la Cour européenne des droits de l’homme a été saisie de l’affaire après que la Cour constitutionnelle a jugé la requête individuelle du requérant irrecevable.
Comment se déroulera le prochain processus ?
Dans la procédure suivante, si les parties envoient des informations ou des documents supplémentaires dans un délai de 8 jours, elles les soumettront à la Cour.
Les documents transmis seront également envoyés à l’autre partie et, si nécessaire, des contre-arguments seront reçus. Ensuite, la Cour tiendra plusieurs réunions secrètes pour rédiger et adopter l’arrêt.
Quand la décision sera-t-elle rendue ?
Puisque cet arrêt est basé sur une révision d’un arrêt de la Grande Chambre, il sera plus facile à rédiger que l’arrêt Yalçınkaya. En effet, la Grande Chambre pourra plus facilement modeler son arrêt par des citations de l’arrêt de la Chambre.
Cette fois, s’il faut s’écarter de l’arrêt de la Chambre, il sera plus facile de formuler l’arrêt en rédigeant les raisons de cet écart. Comme l’arrêt Yalçınkaya contient également des textes préparés sur certaines questions, il est possible que le processus de rédaction se déroule plus rapidement en se référant à cet arrêt.
D’autre part, étant donné que l’arrêt Yalçınkaya n’a pas encore été mis en œuvre et que l’incertitude persiste, et étant donné que la Cour européenne des droits de l’homme voudra classer les dossiers dans une catégorie similaire dès que possible, on peut dire qu’une décision pourrait être rendue dans cette affaire dans un délai plus court que l’arrêt Yalçınkaya.
LIEN VIDÉO DE L’AUDITION :
Vidéo : audience Yasak c. Turquie https://t.co/Looyk3gdUE
Vidéo : audition Yasak c. Turquie https://t.co/guSf9XOebe
Discours du Prof. Dr. Johan Vande Lanotte, avocat du requérant Şaban Yasak | Affaire YASAK à la CEDH | 07 mai 2025 Sous-titres en turc :
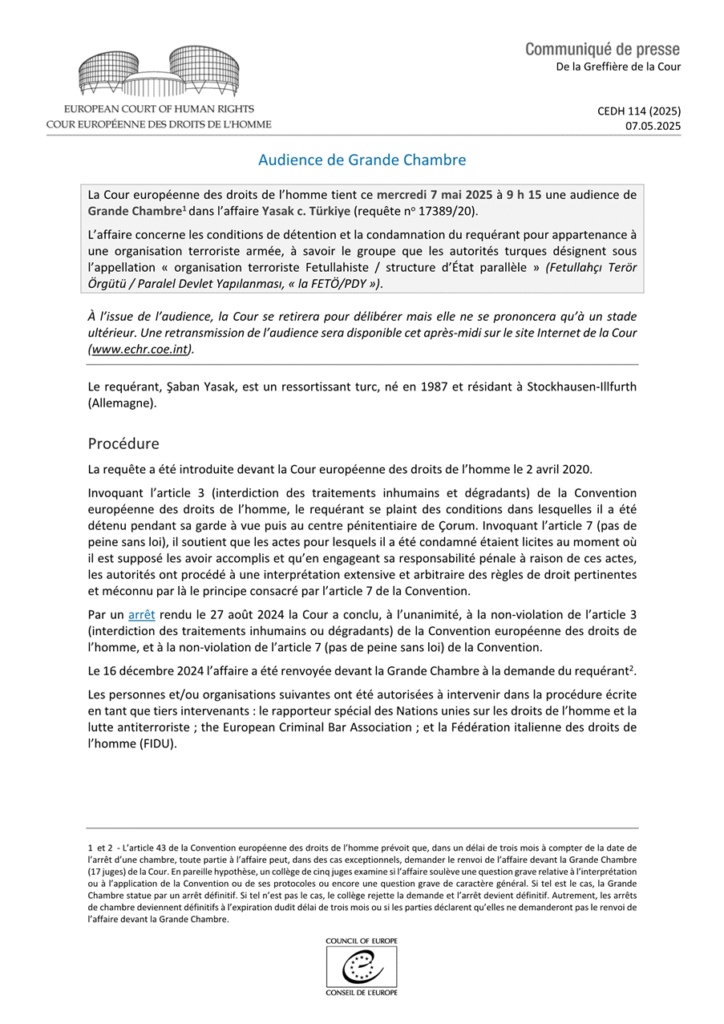
Le droit et les droits de l’homme sont alarmants ;
320 étudiants de l’université détenus sur la base d’accusations forgées de toutes pièces, d’une interdiction de voir un avocat et d’une ordonnance de confidentialité
Dans les déclarations recueillies à la Direction de la sécurité de Gaziantep, la branche antiterroriste a posé aux étudiants de nombreuses questions violant le droit constitutionnel à la liberté de circulation, notamment sur les raisons de leur voyage dans des pays tels que la Bosnie-Herzégovine, l’Albanie, la Macédoine et la Géorgie, sur leur participation éventuelle à des camps à l’étranger, sur l’acheteur de leurs billets d’avion, sur l’hôtel dans lequel ils ont séjourné, sur les personnes qui les ont accompagnés dans les pays visités et sur les personnes qui les ont accueillis. Les étudiants ont également été interrogés sur le fait de savoir si des membres de leur famille avaient déjà fait l’objet de poursuites judiciaires.

Un nouveau type de crime ; « Pourquoi êtes-vous parti à l’étranger ? »
Les avocats et les défenseurs des droits de l’homme affirment que les services de sécurité ont procédé à des interprétations scandaleuses de la définition des infractions. Par exemple, la question « pourquoi êtes-vous allé à l’étranger ? » est devenue un sujet d’interrogatoire. Les motifs de détention incluent la participation au programme Erasmus, les études à l’étranger, les visites à domicile ou les membres de la famille.
L’article 36 de la Constitution garantit le droit à un procès équitable, tandis que l’article 19 fait référence au droit à la liberté et à la sécurité de la personne. Le droit d’un détenu de s’entretenir avec son avocat en privé et en toute confidentialité ne peut être restreint que dans des circonstances très limitées, sur décision d’un juge et à titre temporaire. Les articles 147 et 154 du code de procédure pénale (CPP) contiennent également des dispositions claires à cet égard. Selon les articles 147 et 154 du code de procédure pénale (CPP), le droit des suspects d’avoir un accès privé et confidentiel à un avocat ne peut être limité que temporairement par la décision d’un juge dans certaines conditions. En outre, selon la loi sur les avocats, l’entrave au droit à la défense est une attaque contre la loi elle-même.
L’interdiction faite aux détenus de rencontrer leurs avocats pendant 24 heures, l’impossibilité pour les avocats de la défense d’accéder aux dossiers et la tenue de réunions secrètes affectent directement le droit à un procès équitable. Dans le cadre de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et de la Constitution de la République de Turquie, ces pratiques violent à la fois le droit national et les conventions internationales.
Des allégations de torture et de mauvais traitements dans certains centres de détention ont également été mises en évidence, mais il n’est pas possible d’enquêter sur ces allégations et d’en rendre compte en raison de l’interdiction d’accès aux avocats. Les experts juridiques avertissent que l’interrogatoire des détenus sans avocat les rend vulnérables aux mauvais traitements.
Rapport « Turquie » du ministère australien des affaires étrangères :
« Les membres des mouvements de service à haut risque »

Les pratiques impliquant le recours à l’état d’urgence ont été incluses dans le « rapport sur la Turquie » de l’Australie. Dans le rapport d’information sur la Turquie publié par le ministère australien des affaires étrangères et du commerce (DFAT), il est indiqué que des dizaines de milliers de personnes ont été licenciées, détenues et arrêtées en vertu de décrets d’urgence, accusées d’activités « légales ». Le rapport indique clairement que les membres du mouvement Hizmet courent un risque élevé : « Le DFAT estime que les personnes accusées d’appartenir au mouvement Gülen courent un risque élevé de discrimination sociale, y compris de stigmatisation, en raison de la publication de leur nom.
Le rapport contient également des conclusions importantes sur la torture et les mauvais traitements : « Très peu de personnes licenciées ou arrêtées ont été accusées d’avoir participé à la tentative de coup d’État. La plupart ont été arrêtées au motif de leur appartenance présumée au mouvement et de la nomination irrégulière d’agents publics à des fonctions publiques. La plupart des personnes arrêtées après la tentative de coup d’État de 2016 ont été soumises à la torture en détention. Amnesty International et Human Rights Watch ont enregistré des cas de passages à tabac, de positions de stress, de privation de nourriture, d’eau et de soins médicaux, de simulacres d’exécution, d’agressions sexuelles et de viols. La torture est généralement pratiquée par la police, souvent au cours d’interrogatoires dans des centres de détention non officiels et parfois en présence de médecins de la police. Parmi les victimes figuraient des juges, des procureurs, des officiers de police, des soldats et d’autres fonctionnaires.
Les activités d’Amnesty International interdites en Russie
La Russie interdit Amnesty International dans le cadre de la dernière vague de répression contre l’opposition et les militants. Le 19 mai 2025, les autorités russes ont interdit à Amnesty International d’exercer ses activités en tant qu‘ »organisation indésirable », qualificatif qui, en vertu d’une loi de 2015, constitue une infraction à l’égard de ce type d’organisations.

Agnès Callamard, secrétaire générale d’Amnesty International, a déclaré que cette décision s’inscrivait dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement russe pour réduire au silence les dissidents et isoler la société civile. « Si les autorités pensent qu’en qualifiant notre organisation d' »indésirable », elles mettront fin à notre travail de documentation et de dénonciation des violations des droits de l’homme, elles se trompent lourdement, bien au contraire », a-t-elle déclaré. « Nous ne céderons pas aux menaces et nous continuerons à œuvrer pour que les citoyens russes puissent jouir de leurs droits fondamentaux sans discrimination.
https://apnews.com/article/russia-amnesty-international-3e6c3d50042b2b27cdd5f20eebafe70c
Augmentation du nombre de requêtes contre la Turquie devant la Cour européenne des droits de l’homme

Le nombre de requêtes contre la Turquie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a atteint 21 600, soit 35,8 % du total des requêtes. Les affaires liées à l’utilisation de ByLock et à l’organisation Gülen figurent en bonne place dans l’agenda de la Cour européenne des droits de l’homme.
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a annoncé ses statistiques pour 2024. Selon les données de la CEDH, la Turquie est le pays qui aura le plus grand nombre de requêtes à son encontre en 2024.
Le nombre total de plaintes déposées auprès de la Cour européenne des droits de l’homme par 47 pays européens s’élève à 60 350. 35,8 % d’entre elles sont des plaintes pour violation des droits originaires de Turquie. Cela signifie que 21 600 jugements sont en attente. Avec ce nombre, la Turquie est de loin le pays le plus avancé. La Turquie est suivie par la Russie, qui a quitté le Conseil de l’Europe, avec 8 150 requêtes et l’Ukraine avec 7 700 requêtes. Les demandes des 44 pays restants s’élèvent à 22 900.
La Turquie s’est également classée première en 2023. Cependant, le nombre en 2023 était plus élevé qu’en 2024.
Dans 67 des 73 jugements rendus contre la Turquie, au moins un article de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) a été considéré comme ayant été violé.
RAPPORT DE TIERS DE FIDU DANS L’AFFAIRE BAN C.
Déclarations de la FIDU (Fédération italienne des droits de l’homme), qui a envoyé l’un des rapports de tiers en faveur de l’interdiction, contre la décision d’interdiction.

La Fédération italienne des droits de l’homme (FIDU) soumet la présente tierce intervention avec l’autorisation du Président de la Cour européenne des droits de l’homme (« la Cour ») conformément à l’article 36, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’homme et à l’article 44, paragraphe 3, du règlement de la Cour.
Fondée en 1987, la FIDU défend les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit.
Elle a apporté son expertise sur l’indépendance judiciaire et les lois antiterroristes dans des affaires telles que Altintas c. Turquie et l’exécution du verdict de Yüksel Yalcinkaya. La FIDU a analysé de nombreuses décisions de justice sur les pratiques antiterroristes de la Turquie et a suivi de près des affaires très médiatisées, notamment l’affaire des « jeunes filles » à Istanbul.
Grâce à ses observations dans les salles d’audience et à ses consultations avec des experts juridiques et la société civile, la FIDU a acquis des connaissances importantes sur les affaires liées au terrorisme en Turquie. Ces observations découlent de sa vaste expérience dans ce domaine. La FIDU a acquis des connaissances importantes sur les affaires de terrorisme en Turquie.

Les observations suivantes découlent de leur vaste expérience dans ce domaine. Le présent mémoire a pour objet de fournir une analyse experte du contexte juridique et factuel de l’application de la législation antiterroriste turque, en particulier de l’article 314 du code pénal turc et de la loi antiterroriste n° 3713, à la lumière des exigences de prévisibilité et de sécurité juridique énoncées à l’article 7 de la Convention, afin d’aider la Cour dans son examen de l’affaire Yasak c. Turquie.
La FIDU soumet cette intervention pour soutenir un jugement équitable dans l’affaire Yasak c. Turquie, pour renforcer l’état de droit et pour garantir que les mesures antiterroristes sont compatibles avec les normes en matière de droits de l’homme.