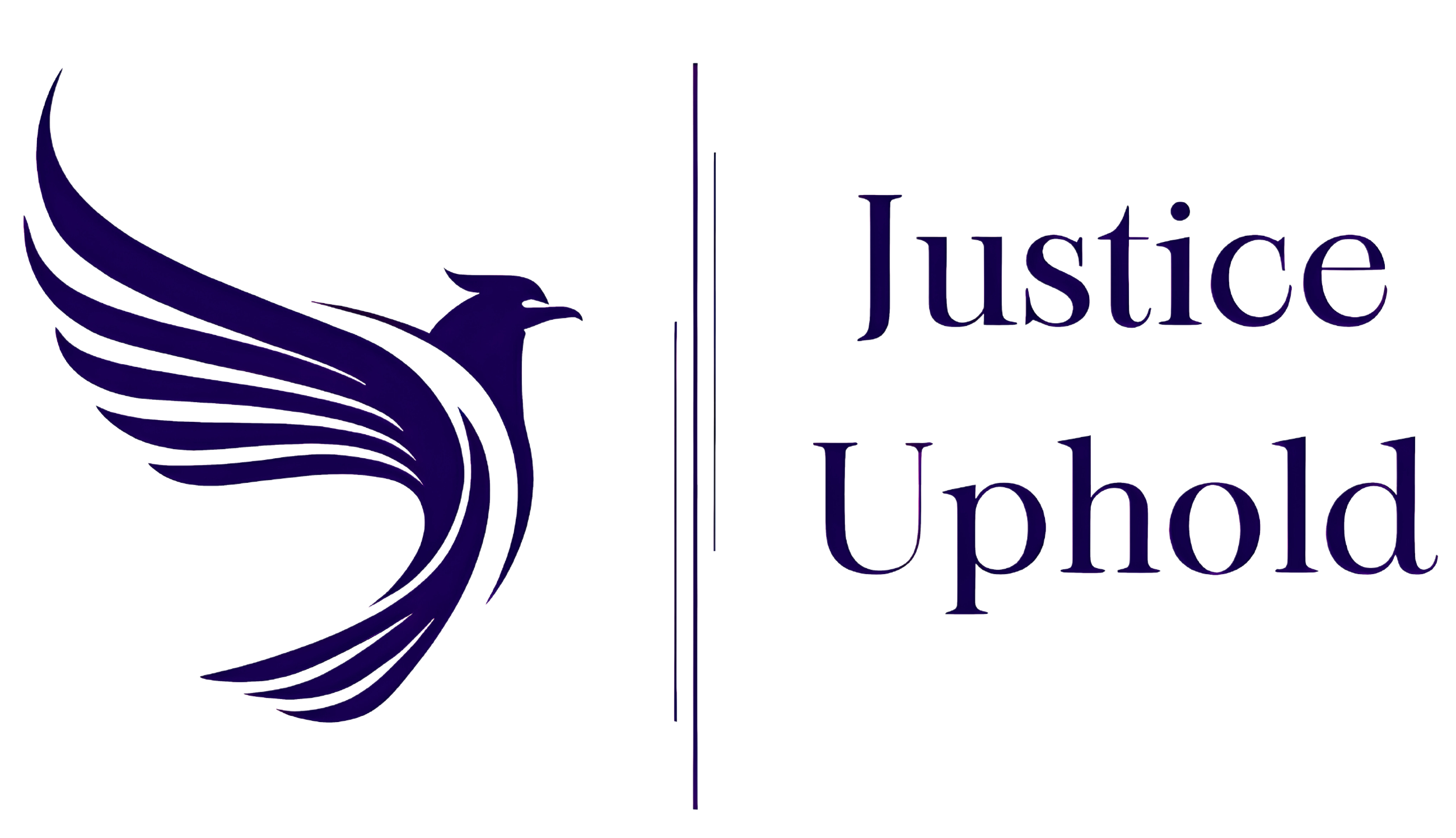Tenue le 7 mai 2025 à la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), l’affaire Yasak c. Turquie a marqué un tournant remarquable tant par son contenu juridique que par ses interventions internationales. La décision controversée de la deuxième chambre de la CEDH à l’encontre du requérant, condamné pour « appartenance à une organisation terroriste armée » en raison de ses activités en lien avec le mouvement Gülen, a été remise sur la table lors de cette audience. Le cas du requérant, Şaban Yasak, pourrait servir de test décisif pour les affaires provenant de Turquie après l’arrêt Yalçınkaya de la Cour européenne des droits de l’homme, qui a créé un précédent.
Dans son arrêt annoncé le 27 août 2024, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que la condamnation de Yasak ne violait pas le principe « pas de crime et pas de peine sans loi » consacré par l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme. Toutefois, cet arrêt a été largement critiqué, notamment en raison de la faiblesse des preuves et de l’absence de présentation concrète des éléments constitutifs de l’infraction. L’absence de tout élément de preuve autre que le compte du requérant à la Bank Asya, les déclarations des témoins et les enregistrements HTS a mis en évidence le fait que la condamnation reposait sur des bases peu solides. Il a également été indiqué que certaines des déclarations de témoins sur lesquelles la Cour européenne des droits de l’homme s’est appuyée dans son arrêt ont été versées au dossier après le procès, mais n’ont pas été discutées lors des phases d’appel ou de cassation.
Abdullah Aydın, chef du département des droits de l’homme du ministère de la Justice, et les avocats Stefan Talmon et Olgun Değirmenci ont représenté le gouvernement turc à l’audience à Strasbourg. Le gouvernement a soutenu que les actions du requérant indiquaient son appartenance à une organisation terroriste et a affirmé que la procédure avait été menée équitablement. Il a également fait valoir que les accusations étaient prévisibles, mais que sa défense présentait des lacunes notables. En particulier, il a été admis que des actions telles que le dépôt d’argent à la Bank Asya, l’utilisation d’un nom de code ou le séjour dans des maisons communautaires ne constituaient pas une infraction en soi. De manière plus frappante, il a été soutenu qu’il incombe aux individus de prouver leur innocence, ce qui est en contradiction flagrante avec les principes de l’État de droit.
Johan Van De Lanotte et Johan Heymans, qui ont défendu le requérant, ont souligné que la deuxième chambre de la Cour européenne des droits de l’homme avait examiné le dossier de manière incomplète et préjudiciable, et que la condamnation ne comportait ni les éléments matériels ni les éléments moraux du crime.
Entre-temps, un événement important s’est produit avant l’audience : le rapporteur spécial des Nations unies est intervenu dans l’affaire Ban en émettant un avis de tierce partie.
Avant l’audience de l’affaire Yasak c. Turquie devant la Cour européenne des droits de l’homme le 7 mai 2025, un événement important s’est produit. Ben Saul, rapporteur spécial des Nations unies sur la lutte contre le terrorisme et les droits de l’homme, est intervenu dans l’affaire en tant que tierce partie. Dans ses observations, le rapporteur a souligné que la définition du terrorisme a été arbitrairement élargie dans les procès liés au mouvement Gülen, que le principe de légalité rétroactive dans les pratiques pénales a été violé et que les procédures judiciaires en Turquie ne sont pas conformes aux normes en matière de droits de l’homme.
Il s’agissait d’une intervention pionnière dans les affaires en cours contre la Turquie devant la Cour européenne des droits de l’homme, qui a fait naître l’espoir d’une réévaluation de l’arrêt Ban.

L’affaire Yasak c. Turquie, qui a été entendue par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) le 7 mai 2025, a connu un développement historique. Le rapporteur spécial des Nations unies sur la lutte contre le terrorisme et les droits de l’homme, le professeur Ben Saul, a présenté une tierce opinion dans cette affaire. Cette intervention est une première pour les requêtes du rapporteur spécial des Nations unies contre la Turquie devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Intervention critique en termes de droits de l’homme internationaux
L’avis soumis par le rapporteur spécial des Nations unies analysait l’affaire à la lumière des principes universels de protection des droits de l’homme dans le contexte de la lutte contre le terrorisme. L’avis du professeur Saul critique directement l’approche adoptée par la deuxième chambre de la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt et signale une violation de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) (principes de légalité et de prévisibilité).
Les points suivants ressortent particulièrement de l’avis :
– Définition vague du terrorisme : Il est indiqué que les activités liées au mouvement Gülen au cours de la période 2011-2014 ne peuvent être définies comme des « infractions terroristes » et que les activités au cours de cette période ne constituent pas clairement une infraction pénale.
– Absence d’élément moral de l’infraction : Il est souligné qu’il n’existe aucune preuve concrète que le demandeur était au courant de la tentative de coup d’État, qui est l’objectif ultime de l’organisation, et que seules des hypothèses abstraites telles que « il aurait dû savoir » sont utilisées.
– Critique des activités secrètes : Il est indiqué que l’utilisation de « noms de code » et de comportements similaires peut être utilisée pour assurer la sécurité personnelle dans les régimes répressifs et que de telles actions ne devraient pas être automatiquement criminalisées.
– L’imprécision du TCK 314 : Il est indiqué que des critères tels que « la continuité, la diversité et l’intensité », qui permettent à de nombreuses personnes en Turquie d’être jugées selon les mêmes critères, sont utilisés de manière ambiguë et arbitraire.
Ce jugement devrait constituer un précédent pour des milliers d’affaires en Turquie.
L’avis du rapporteur spécial des Nations unies jette un éclairage non seulement sur le cas du requérant, mais aussi sur des milliers de cas similaires déposés après le 15 juillet. Le rapporteur a constaté que dans la plupart de ces cas, l’intention criminelle individualisée n’a pas été examinée et que les peines ont été imposées dans une logique collective.
Dans ce contexte, l’arrêt de la Grande Chambre pourrait non seulement décider du sort de Şaban Yasak, mais aussi marquer un tournant juridique pour la liberté d’expression, la liberté de religion et le droit à un procès équitable en Turquie.
Le document de synthèse complet est disponible sur le lien suivant :
097554080931910?t=d5Nwy3ghLDyc7C7OJ_LdBQ
Que se passe-t-il ensuite ?
Les parties ont eu 8 jours pour soumettre des informations supplémentaires. Après cette période, la Cour rédigera son arrêt en séance secrète. L’arrêt devrait être rédigé conformément au précédent de Yalçınkaya et être annoncé dans un délai plus court.
Cette affaire ne concerne pas seulement la liberté de Şaban Yasak ; elle pourrait avoir des implications considérables pour l’État de droit, l’indépendance judiciaire et la protection des droits fondamentaux en Turquie. L’intervention du rapporteur spécial des Nations unies peut garantir que ce processus soit examiné plus attentivement dans le cadre du droit international des droits de l’homme.
Compte rendu d’audience :
Vous pouvez accéder à la vidéo de l’audience publiée sur le compte officiel X (anciennement Twitter) de la CEDH ici: